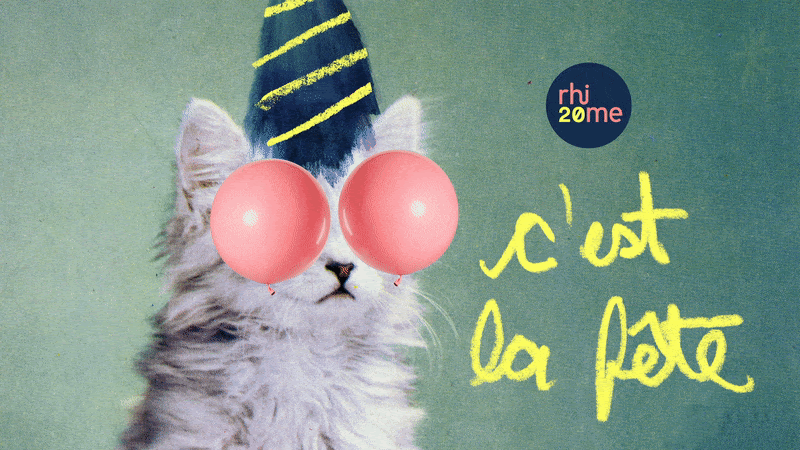Texte tiré d’une série imaginée pour le 20e anniversaire de Rhizome et intitulée Suis-je seul·e quand j’écris? ╱ Neuf artistes et écrivain·e·s ayant collaboré avec Rhizome en disent plus sur leur expérience de création en arts littéraires. Simon Dumas, directeur artistique et fondateur de Rhizome, est de ceux et celles là, sinon le premier il va sans dire!
—
Suis-je seul quand j’écris? Je ne suis jamais seul en littérature, ni quand je lis ni quand j’écris. Même si j’écris peu. Mon amour des lettres ne m’a pas tant mené à un métier d’écrivain — quoique j’aspire à l’écriture, que j’essaie d’écrire des livres et que j’en publie parfois — qu’à une activité connexe, quelque peu singulière, qui consiste principalement à mettre en scène des écrivains. Enfin, je devrais ici user de prudence tant cette notion de « mise en scène » est lourdement chargée de sens, d’attentes… d’une sorte d’aura dont les cernes luminescents sont imprégnés d’une force, peut-être celle d’inertie d’une tradition séculaire. « Moi, je fais un métier qui existe », m’avait lancé un ami metteur en scène alors que nous conversions de la chose. « Depuis mille ans! », avait-il ajouté. Sur le coup, je n’avais su que répondre. Ça m’avait cloué le bec, coupé l’élan.
Et le mien, il n’existe pas?
Ça va faire vingt ans qu’avec Rhizome je produis, crée, fais tourner toutes sortes de projets — spectacles, installations, performances — dans lesquels des écrivains, tous genres confondus, s’impliquent. Ils écrivent des textes inédits, participent aux répétitions, aux sessions d’idéation, de travail, puis ils montent sur scène. Bref, ils ont accepté de dévier de leurs habitudes de création, de sortir de la solitude de l’écriture, de se soumettre à un décalage.
« Moi, je fais un métier qui existe. »
J’avais été choqué sur le coup. Puis, à la réflexion, je me suis dit qu’il avait raison. Mon métier n’existe pas puisqu’il est volontairement situé dans une sorte de no man’s land disciplinaire. Mon office est décalé, c’est-à-dire qu’il a élu domicile dans la case d’à côté. Il n’est pas chez lui, ce ne sont pas ses affaires. Il manipule des outils qui ne sont pas les siens. Or, ce décalage, c’est précisément ce qui nous intéresse : que se passe-t-il si, provenant de la littérature, ma destination devient la représentation plutôt que le livre?
Un autre ami, le poète Bertrand Laverdure, m’a récemment demandé si j’allais bientôt m’intéresser à la réalité virtuelle. J’ai répondu que non, qu’il me semblait que je n’avais pas encore exploré tous les possibles de la représentation, de ce que ça implique si moi, imposteur, je me saisis des treize systèmes de signes du théâtre [i]. Plus je la déplie, plus la représentation déploie devant mon regard ébahi ses multiples merveilles. Elle a entre autres ceci de particulier que l’émetteur et le récepteur des signes partagent le même espace-temps. C’est fort différent du livre où, forcément, il y a une coupure dans l’espace et dans le temps (un décalage) : l’écrivain n’est pas dans le même lieu ni dans le même temps que le lecteur. Je ne suis pas en train de dire que mon intérêt se déplace du livre (un support) vers la représentation (un autre support). Au contraire, à mesure que j’avance dans mon ouvrage, que je découvre ce que cela implique de passer de l’écrit au dit, du papier au vivant, d’un espace virtuel à un autre réel, ce sont les lignes de force qui s’établissent entre ces deux modes d’expression artistique qui me fascinent. Un texte est un espace entièrement virtuel où tout — récit, expériences, sensations — se déroule dans le giron du langage. Le théâtre, quant à lui, propose une expérience basée sur la confrontation entre la matérialité du lieu, des lumières, des corps et l’immatérialité de la fiction (ou du récit, c’est selon). Bien sûr, le langage traverse le théâtre comme il traverse la grande majorité des sphères d’activité de la société. C’est d’ailleurs cette transversalité du langage qui en fait un matériau de création si particulier : un matériau culturel, c’est-à-dire défini et constamment façonné par ses communautés de locuteurs. Le langage devient « matériau » — et non « mode de communication » ou encore « outil » — lorsqu’il est à la source d’une démarche artistique. Autrement dit, je soutiens que la littérature, c’est fondamentalement de l’art créé à partir du matériau « langage » et que l’art survient lorsqu’une pensée soumet un matériau à un stress (ou à un décalage) et que celui-ci lui oppose une résistance.
Soumettre à un stress, qu’est-ce à dire? Ce pourrait être taper sur une pierre avec un ciseau. En littérature, ce serait triturer la syntaxe, détourner le sens ou favoriser les sens multiples, emprunter systématiquement les chemins de traverse qui s’ouvrent soudainement lorsqu’on écrit. Par opposition, le langage des manuels d’instructions est le moins stressé du monde. Relaxé, il devient utilitaire, communicationnel, usuel.
Le langage comme matériau résiste lorsque le sens des mots refuse d’être univoque, qu’il impose son historicité, laquelle est façonnée par des générations de gens qui ont voulu mettre de l’emphase, imager leur discours ou qui avaient tout simplement mal assimilé le sens véritable de tel terme ou de telle expression. Ce lent glissement sémantique des mots qu’impose l’usage charge graduellement la langue d’une certaine expérience collective. Avec le temps, les mots s’usent. Ils perdent en précision mais gagnent en nuance. Et c’est ce décalage entre les différents sens d’un mot — mais aussi le décalage entre le désir écrivant et l’expérience lectrice — qui donne au texte littéraire son épaisseur et qui fait qu’on peut le forer, en tirer des carottes dont les cernes, situés à différentes profondeurs, recèlent des révélations surprenantes sur l’auteur, mais aussi sur notre société, notre histoire. Sur nous-mêmes aussi.
Moi, ce que je veux faire, c’est confronter cette approche du langage-comme-matériau avec la matérialité d’un lieu, des lumières sur des corps, la vibration d’une parole, la physicalité de l’auteur, de celui qu’on sait à l’origine de ce qu’on entend, sa relation physique aux spectateurs, mais aussi à son propre texte. Voilà un chemin que je n’ai pas fini d’arpenter. Et je n’ai pas encore mentionné le partage, le fait que celui qui dit et celui qui écoute sont ensemble dans le même espace et le même temps, comme quelque chose qui serait à la fois communion (être ensemble) et contrainte (fixité du temps de la représentation).
Le partage.
Un troisième ami, Jean-Yves Fréchette — un homme de création qui, au cours de sa respectable carrière, a fait littérature de tout bois — affirmait lors d’une entrevue que la démarche de Rhizome invite à festoyer autour d’un texte littéraire. Disant cela, il faisait écho à cet autre ami et partenaire, Philippe Franck — critique, artiste et directeur de Transcultures, un OBNL culturel belge— qui lui me qualifie de « metteur ensemble ». Effectivement, je n’aime rien tant que de rassembler des gens autour d’un texte littéraire. Une démarche que je qualifie parfois de « faire lire ». Et le premier cercle de lecteurs est celui des collaborateurs : musiciens, cinéastes ou personnes d’images, éclairagistes, chorégraphes. Il est beau de voir un groupe, dont l’auteur fait partie, se rassembler autour d’un texte et y forer des carottes. Les trous qu’elles laissent dans la matière textuelle laissent passer une sorte de lumière (spéciale ;-)) éclairant un chemin singulier, celui qu’ont emprunté les artistes conviés autour du texte. De part et d’autre de celui-ci, des sentiers de traverse s’ouvrent inopinément. Il appartient à ceux du second cercle de les emprunter ou non.
Ce second cercle est formé des spectateurs.
Enfin, tout cela est probablement d’une évidence crasse. Il y a des choses évidentes — élémentaires même pour mon ami metteur en scène — que je mets des années à découvrir. Mais, les découvrant, je n’emprunte pas le même chemin que celui qui est tracé par les écoles puis « le métier ». Apprendre puis embrasser un métier est une noble chose. La transmission d’un savoir-faire, d’une pensée qui peut avoir mille ans… Ces courroies de transmission sont certainement indispensables, je ne dis pas le contraire. Moi-même, j’ai reçu une formation. J’ai été formé et cette forme qu’on m’a donnée — disons qu’elle a l’aspect d’une cheville ronde — j’essaie depuis vingt ans de la faire entrer dans un trou carré. J’ai dévié de la destination qui avait été tracée pour moi, j’ai choisi la case d’à côté.
Suis-je seul en littérature? Bien que la lecture et l’écriture soient des activités solitaires, on n’est jamais seul. Chaque texte charrie une multitude et je ne peux en lire un sans qu’un son, une image ou un autre texte ne s’impose à moi, lesquels à leur tour me font penser à l’artiste qui pourrait cristalliser ou faire vibrer cette apparition. Mais soyons clairs : ce que je fais à travers Rhizome n’est ni nouveau ni unique. Qui plus est, force est de constater que ce fameux no man’s land disciplinaire est de plus en plus peuplé d’artistes se disant soit pluri, inter, trans ou indisciplinaire. Est-ce la fin des disciplines artistiques pour autant? Je ne pense pas. Même si les pratiques sont multiples et que les frontières éclatent, il me semble que les artistes réfléchissent leur art « à partir » de quelque chose comme une origine. Pour ma part, je demeure une personne de lettres. C’est d’où je viens.
Simon Dumas — 30 janvier 2020
[i] Les treize systèmes de signes du théâtre selon Tadeusz Kowzan : la parole, le ton, la mimique, le geste, le mouvement, le maquillage, la coiffure, le costume, l’accessoire, le décor, l’éclairage, la musique et le bruitage.