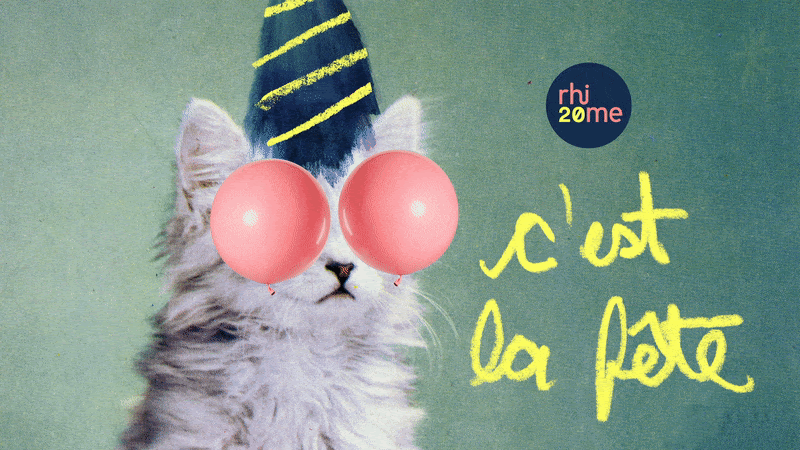Texte tiré d’une série imaginée pour le 20e anniversaire de Rhizome et intitulée Suis-je seul·e quand j’écris? ╱ Neuf artistes et écrivain·e·s ayant collaboré avec Rhizome en disent plus sur leur expérience de création en arts littéraires. Juliette Bernatchez, notre complice de bureau, aussi codirectrice du Mois de la Poésie.
—
J’ai récemment écrit un texte pour la soirée de financement d’un collectif de théâtre documentaire féministe. Les Reines explorent la solidarité féminine et le rapport des femmes au pouvoir, par l’entremise d’un spectacle qui pourrait s’apparenter à un essai théâtral.
Je devais écrire sur ce thème, mon rapport au pouvoir en tant que jeune femme, universitaire, autrice. Je terminais en disant que j’aimerais être une femme de parole, comme celles qui m’ont précédées. Je montais une filiation, je nommais certaines femmes de lettres, artistes, qui accompagnent mon parcours en tant que créatrice. Des femmes telles que Pauline Julien, Anne-Claire Poirier, Anne Hébert ou Geneviève Desrosiers. Je terminais en disant que, contrairement à ces femmes, je n’avais pas de porte-voix à offrir, car j’avais du mal à ne pas égarer le mien.
Si j’égare souvent mon porte-voix,
comment puis-je avoir la légitimité d’en offrir un aux autres;
comment puis-je identifier ma parole militante, intellectuelle et créatrice comme étant porteuse de sens, si mon sentiment d’imposture prend parfois toute la place;
comment puis-je me sentir adéquate face à tout ce qui se fait et à tout ce que j’ai envie de créer.
Ces questionnements persistent et traversent mon quotidien de récente diplômée, d’autrice, de travailleuse culturelle. Car il faut dire, j’ai les moyens de travailler à ce pour quoi je travaille.
Je suis privilégiée, éduquée, sortie du deuxième cycle universitaire sans dette, ou si peu.
J’ai un mode de vie sain, des passe-temps, des ami·e·s.
J’ai une bonne gestion de mes finances, de mon temps.
Je n’ai étonnamment pas besoin de psychothérapie.
Et je ne me tanne jamais de manger des sandwichs aux tomates.
Mais je dois dire que je cherche constamment les moyens de mes ambitions.
Mes idées dépassent souvent la juste mesure, par leur nombre ou leur contenu.
Je dis oui à toutes les opportunités.
Je veux toujours tout faire pour que tout le monde ait du fun.
Je fonce dans le tas. J’aimerais symboliquement foutre le feu partout.
* * *
J’ai écrit en silence tout au long de mon baccalauréat. J’ai aligné les mots compliqués, rédigé des phrases que je ne serais jamais capable d’énoncer en un souffle. J’essayais constamment de justifier ma place dans le rang des universitaires. Une tentative pour être adéquate.
Je me suis longtemps identifiée comme une étudiante en littérature.
J’ai complété un baccalauréat et une maîtrise en histoire littéraire. Je me suis spécialisée en littérature des femmes québécoises pendant la période de la Révolution tranquille. Ça a été un gros morceau de moi-même. Je commence tranquillement à oublier ces grands moments de down, lorsque l’idée de tout crisser-là t’attend au seuil. Mais je me rappellerai toujours des très grands highs. Mon plus vertigineux a été le jour où j’ai trouvé un article de journal que je cherchais depuis plus de six mois. Je ne pouvais pas déposer mon mémoire sans avoir trouvé cet article. Je m’étais rendue plusieurs fois à la BANQ du Vieux-Montréal pour chercher dans les fonds d’archives, j’avais contacté le journal, épluché les microfilms. Je l’ai finalement trouvé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale, littéralement à deux pas de chez moi. Je suis pas mal certaine qu’il n’y a pas un trip d’ecstasy qui vaille ça.
Ce n’est que depuis peu que j’écris délibérément comme j’aimerais livrer mon texte. Je dis délibérément, car à un certain moment dans mon parcours, le désir m’est venu de vulgariser mes recherches en participant à des colloques et à des tables rondes. Des lieux où il était nécessaire que mes raisonnements soient limpides par l’unique moyen de ma voix et de mon corps comme support. J’ai donc commencé, sans le savoir, à rédiger tout haut. J’ai saisi l’opportunité de livrer dans le porte-voix.
C’est à ce moment que j’ai compris que je pouvais réaliser des recherches intellectuelles sans toujours chercher à le faire au moyen de mots inaccessibles ou de tournures de phrases empesées. Plus encore, j’ai compris à ce moment que je pouvais appartenir à ce monde sans avoir à me justifier sans cesse.
De la même façon, j’ai pris du temps à me convaincre que j’étais autrice, ou quelque chose qui s’en rapproche. C’est évidemment le capital symbolique qui a assuré cette légitimation. J’ai reçu une bourse et j’ai automatiquement été comprise dans les rangs.
J’en suis à mes débuts.
Mais je crois que j’aurai toujours du mal à décrire ma démarche artistique en poésie. Elle est basée sur mon constant tiraillement. Sur mon ambivalence. Sur ma volonté de déconstruire.
J’ai envie que ma démarche elle-même soit fluide et équivoque.
J’ai aussi envie qu’elle soit anti-cérébrale. Cela implique que mes textes ne soient pas écrits par mon intellect. Cela implique que je laisse tout sortir, surtout mes feelings les plus bruts, les plus spontanés. Tout ne doit pas être trop réfléchi, trop raisonné. J’ai la volonté que mes écrits soient parlables.
C’est pourquoi je persiste à écrire tout haut.
Si je repense à ce porte-voix inutile lorsque inutilisé, à ce porte-voix égaré, perdu quelque part entre l’effroi et l’imposture, je pense surtout à l’auditoire qui écoute, réagit, hoche la tête, les yeux grands comme des deux piastres. À l’auditoire qui me trouve absolument décomplexée, à mon aise, même si je demeure foudroyée par la peur de l’humiliation.
Pour cet auditoire, je reconnais l’importance d’articuler.
Je reconnais l’importance d’ordonner les mots les uns après les autres.
Je reconnais l’impuissance de ma voix rauque et la nécessité de m’en servir.
Mon porte-voix de plastique comme écho de mes grands élans.
Maintenant, c’est systématique.
Je pense à l’auditoire, cette ou ce destinataire, à qui je pourrais très bien prêter le porte-voix. Et je commence tranquillement à changer de discours dans mon rapport à l’écriture et à la performance.
Je ne crois pas qu’il me faille un porte-voix personnel, un porte-voix qui est mien, pour amplifier la parole des autres. Je peux être celle qui, parfois, tient le porte-voix. Celle qui porte la parole des autres au moyen de mes recherches ou de mon travail auprès des organismes culturels. J’estime que j’ai la volonté et l’aptitude de mettre les autres de l’avant, de nommer, de réunir.
Avec mon besoin de transparence et de bouleversements, je me sais absolument perméable face aux mots et aux choses. J’ai besoin d’être traversée par ce que je lis, ce que j’entends, ce que je vois. Je dois être mise face au mur. J’ai besoin d’avoir la possibilité de changer d’idée, de me tromper et de rectifier le tir par mes propres moyens. J’ai besoin de ressentir très fort le vertige de ma solitude de lectrice, d’amie, d’amante. Pour mieux foutre le feu.
Je dois être exigeante pour moi-même.
Tout cela m’appartient.
Mais « suis-je seule quand j’écris »? J’ose dire que non.
Je suis accompagnée de ces artistes, ami·e·s à qui j’ai prêté le porte-voix, celles et ceux qui me l’ont prêté. Je suis accompagnée de ces femmes et hommes qui m’ont précédée, celles et ceux que j’ai lu·e·s, celles et ceux que j’ai côtoyé·e·s. Je suis accompagnée de mes amoureux manqués, de mon militantisme discret, de mes humeurs variables. Je suis donc absolument certaine que je ne créerai jamais seule.
Juliette Bernatchez